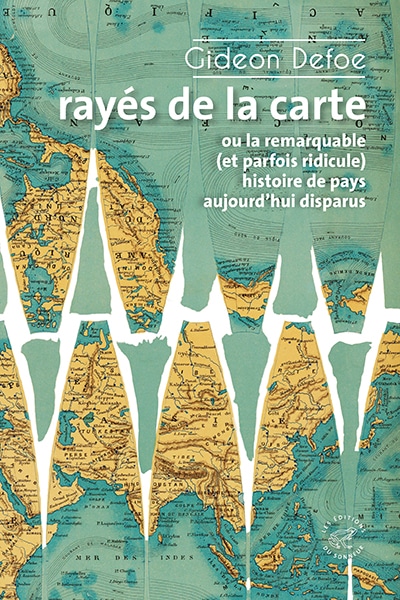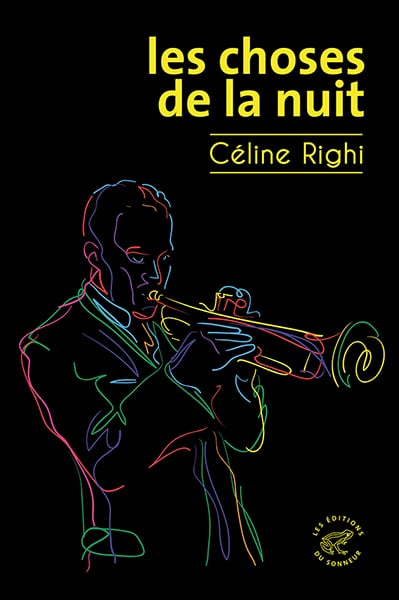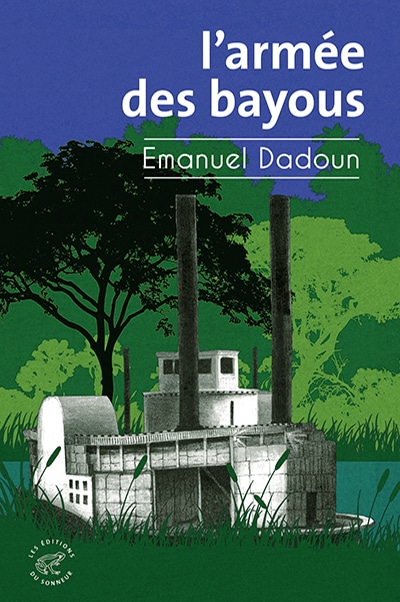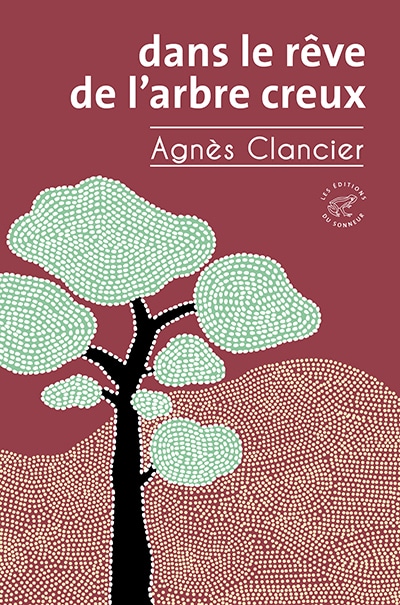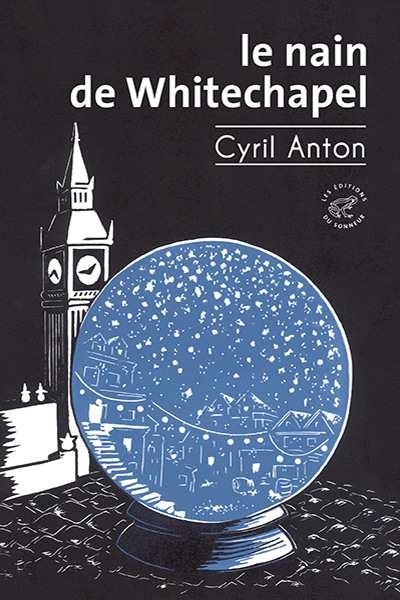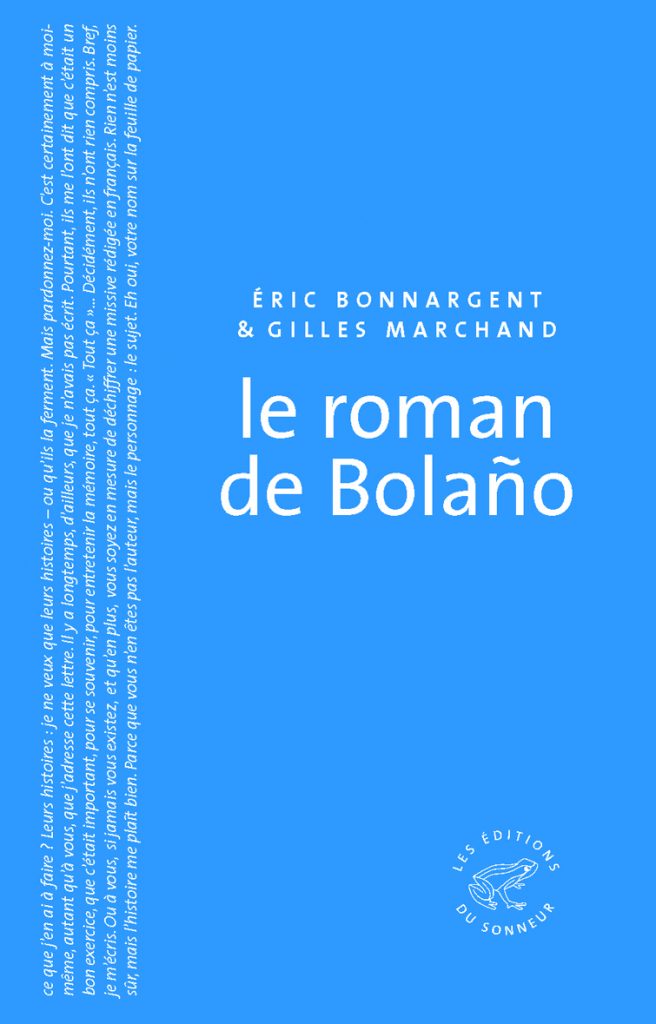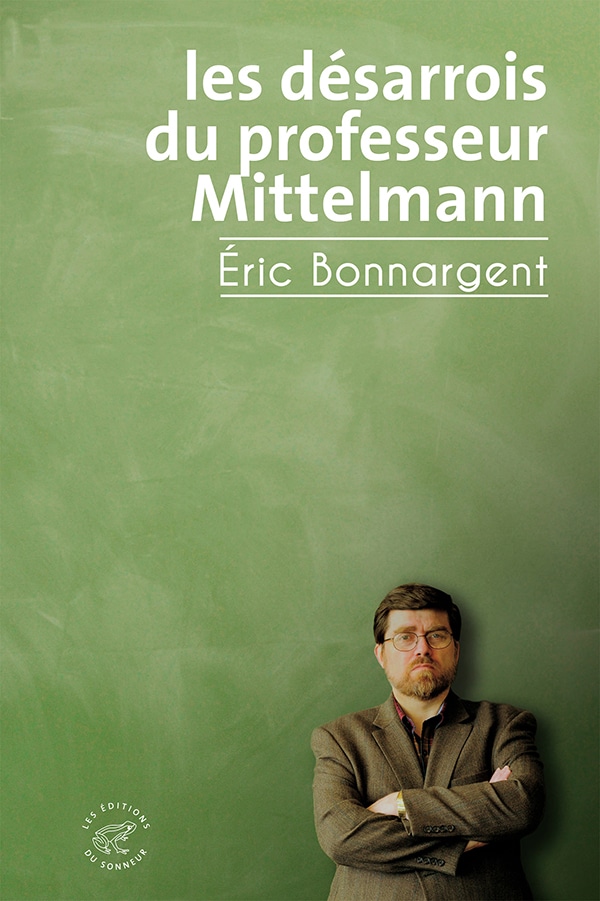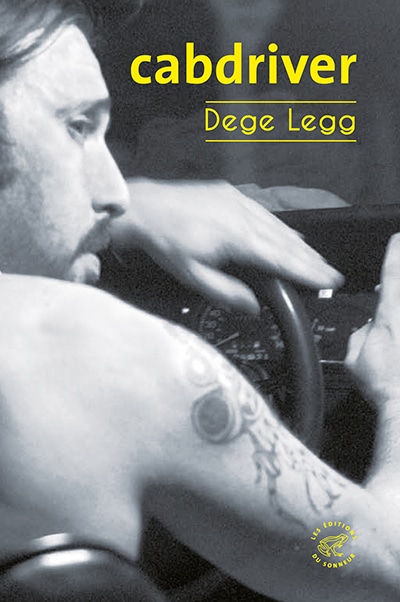No no boy
John Okada
Traduction de l’anglais (États-Unis) d’Anne-Sylvie Homassel • Ouvrage publié avec le concours du Centre national du Livre
Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, le gouvernement américain fait interner les immigrés d’origine japonaise et leurs familles dans des camps. Parmi eux, une partie des jeunes hommes refusent de rejoindre l’armée et de prêter allégeance aux États-Unis – une double objection synonyme de prison. Ces garçons sont surnommés les no no boys.
Unique roman de John Okada, No no boy suit le destin de l’un d’entre eux, Ichiro Yamada, lorsqu’il rentre chez lui, à Seattle, en 1946. Écartelé entre ses origines et son pays de naissance, il va devoir retrouver sa place dans une société qui a fait de lui un ennemi.
Roman majeur sur un épisode oublié de la Seconde Guerre mondiale, No no boy est l’évocation puissante et lucide d’une Amérique où les tensions raciales ne s’apaisent jamais.
À propos du titre
Le double « non » fait référence au questionnaire que le ministère de la Guerre fit remplir en 1942-1943 aux jeunes Japonais-Américains de deuxième génération internés. Les questions n° 27 et 28 étaient destinées à tester leur loyauté envers les États-Unis.
N°27 : Êtes-vous prêt à rejoindre les forces armées des États-Unis et à participer aux combats lorsque cela vous sera demandé ?
N°28 : Êtes-vous disposé à prêter allégeance aux États-Unis d’Amérique et à les défendre en toute loyauté contre toute attaque par des forces étrangères ou nationales, et à renoncer à toute autre forme de soumission ou d’obéissance à l’empereur du Japon ou à d’autres gouvernements, puissances ou organisations étrangères ?
Répondre non à ces deux questions était synonyme d’incarcération.
John Okada est né à Seattle en 1923 de parents issei. Il doit interrompre ses études universitaires en 1942 lorsque, comme plus de 100 000 Japonais-Américains, sa famille et lui sont internés. Il rejoint les rangs de l’armée américaine en 1943. Parlant couramment japonais, il est assigné à une mission de traduction des communications de l’armée japonaise, interceptées par des avions espions.
Après la guerre, il reprend ses études et, pourvu de diplômes en littérature et en bibliothéconomie, exercera divers métiers (bibliothécaire, journaliste…). En parallèle, il écrit des nouvelles, une pièce de théâtre, des essais et No no boy, qui sera publié en 1957. Son second roman fut brûlé par son épouse, après sa mort prématurée, en 1971, d’une crise cardiaque.
En attendant Nadeau • Liliane Kerjan
Avec le roman No no boy, John Okada (1923-1971) fait resurgir toute la période de l’après Pearl Harbor et les conflits de loyauté des citoyens d’origine japonaise face aux exigences du gouvernement des États-Unis. Ichiro, vingt-cinq ans, tiraillé par sa double appartenance, retrouve Seattle après quatre années de prison et de camp d’internement. Un roman clé de la première génération des écrivains asiatiques-américains.
Le sobriquet qui donne son titre au roman s’explique par les faits historiques qui marquent le lendemain de l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 : d’abord, l’internement de plus de 200 000 Japonais, suivi du questionnaire à remplir par les immigrés japonais et leur descendance, destiné à sceller, d’une part, leur incorporation dans les forces armées américaines et, d’autre part, à s’assurer de leur renoncement à l’obéissance à l’empereur du Japon. Assortie d’un serment d’allégeance et d’un engagement à défendre les États-Unis, une telle promesse revenait à se livrer corps et âme à l’Amérique. On appelait « no no boys » les jeunes appelés qui, à ces deux questions, exprimaient deux refus devant le juge. Ils étaient internés au camp de sécurité de Tule Lake en Californie.
Le roman de John Okada s’empare d’une crise existentielle et retrace les difficultés d’ajustement de l’un de ces no no boys à son retour dans la ville où il est né et où il a grandi. Pour retrouver des repères dans une nation hérissée de murs invisibles, Ichiro Yamada va, de manière systématique, explorer ses anciens champs d’appartenance, à commencer par sa famille et ses amis, tout comme il va arpenter les lieux jadis familiers, les artères de Seattle, le campus où il rêvait de terminer des études d’ingénieur. Mais cette tentative de reconquête affective se heurte d’emblée à tous les malentendus : Ichiro demeure aux yeux des autres celui qui a refusé de s’engager. Nul secours de ses parents, arrivés il y a trente-cinq ans pour faire fortune et qui végètent au fond d’une maigre épicerie, nulle affinité avec son jeune frère qui veut intégrer l’armée américaine le jour de sa majorité.
Haine intestine au sein du foyer, méfiance des jeunes Japonais intégrés qui font la fête dans les bars et les salles de jeux de Chinatown, insultes, conflits, luttes d’influence… Ichiro se voit condamné à la prison éternelle, seul contre le monde qu’il a renié. John Okada avance pas à pas dans cette période d’apprentissage tardif, dans l’impossible d’une réinsertion apaisée, cernant l’égarement du jeune homme dont il donne un portrait attachant avec ses stances de sincérité, sa révolte impuissante lorsqu’il crie : « j’ai foutu ma vie en l’air pour vous, pour Ma, pour le Japon ».
Roman de la transition et d’une certaine expiation, No no boy pose la question de l’identité bousculée des Japonais au pays d’Amérique. John Okada en a fait personnellement l’expérience, lui qui écrivit un court poème prémonitoire le 7 décembre 1941, au soir du bombardement : « For my dark features are those of the enemy / And my heart is buried in accidental soil / People will say things and people will do things / I know they will and I must be strong. » (Mes traits sombres sont ceux de l’ennemi / Mon cœur se terre en sol aléatoire / Les gens diront des choses, les gens feront des choses / Je le sais et il faut que je sois fort.) Le poème sort dans la presse et, l’année suivante, son auteur est interné avec sa famille au camp de Minidoka, dans l’Idaho.
La parution en 1957 de No no boy, première œuvre de fiction de cette communauté japonaise-américaine, donne l’ampleur nécessaire à la réflexion sur la malédiction qui a frappé sa génération. Car, à côté des internés comme Ichiro qui tentent un retour à la vie d’antan et à une paix intérieure, il y a ceux qui ont pactisé avec l’armée américaine, gagnant une légitimité – certains sont morts au combat ou rentrés gueule cassée. Partout la tension est palpable, dans la sphère privée comme dans les lieux publics, où les crises se règlent par l’affrontement violent, tout est prétexte à humilier les « Jap boys ».
La discrimination hostile, délibérée, envers les Asiatiques est depuis longtemps monnaie courante en Californie, comme en témoigne le célèbre arrêt réparatoire Yick Wo vs Hopkins, rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1886. Un arrêté municipal de la ville de San Francisco avait interdit l’installation de blanchisseries sans l’accord préalable d’une commission, frappant ainsi deux cents Chinois arrêtés pour pratique illégale. Aujourd’hui, les citoyens d’origine asiatique constituent 15 % de la population californienne, au moment où vient d’être rejeté le retour à la discrimination positive (affirmative action) en faveur de telles minorités. John Okada l’a noté d’emblée, dans la préface : « Tous ceux qui étaient Japonais devinrent l’objet du plus grand mépris. » D’où l’importance d’une trace, la nécessité d’une vigilance pour faire revivre la période, et c’est pourquoi il faut se féliciter de la renaissance du roman et de sa traduction en français.
Le retour d’Ichiro permet à John Okada de balayer un large spectre d’émotions et de violences primitives, la dynamique du refus, l’ostracisme, la culpabilité, la pulsion victimaire, mélange instable dans un parcours rendu vivant par ses dialogues vigoureux qui intègrent des points de vue contradictoires au fil des rencontres. Des brutes, des petites frappes, des écorchés, mais aussi quelques bienveillants tel un patron pour qui cet après Pearl Harbor est « une énorme tache noire dans l’histoire du peuple américain ». Mais l’apprentissage d’une sagesse se fait là au prix fort : la mort passe à diverses reprises, faisant le tri et l’élagage des pesanteurs et des erreurs. Borne historique, certes, et, ne serait-ce que par son titre, No no boy a le grand mérite d’être toujours d’actualité par sa réflexion sur l’identité composite des enfants d’immigrés de première génération nés à l’étranger, sur le temps perdu, sur la fidélité aux traditions ancestrales, sur la validité d’un jugement pris dans des circonstances exceptionnelles : sa pertinence et sa richesse résonnent largement aujourd’hui dans nos sociétés mêlées et métissées.
À l’échelle américaine, No no boy rappelle opportunément la revendication d’une présence depuis un siècle des Japonais de souche et de sol sur la côte Ouest des États-Unis, ainsi que le jalon de leur entrée en littérature. John Okada a écrit des essais, des nouvelles, des pièces de théâtre, mais c’est son unique roman qui fait date. Son cheminement enchantera fouilleurs et fureteurs de tous poils. Introuvable après sa première édition en 1957, un exemplaire d’occasion est déniché dans une librairie de San Francisco par le groupe des « quatre cavaliers », écrivains militants de la littérature asiatique-américaine – Jeffery Paul Chan, Frank Chin, Lawson Fusao Inada et Shawn Wong –, qui lancent une cagnotte pour le faire réimprimer. C’est chose faite en 1976, pour bien ressusciter la présence du romancier fondateur, lequel s’installe pour de bon grâce à une réédition en 2014, suivie de traductions, et au soutien de l’écrivain le plus en vue de leur communauté, Viet Thanh Nguyen, couronné par le Pulitzer pour Le sympathisant.
Il faut lire No no boy comme un rappel salutaire des lendemains tragiques de Pearl Harbor, comme le récit du désarroi d’un jeune rebelle écartelé entre deux sociétés, mais aussi comme un témoignage littéraire des violences politiques de masse autour des droits de l’homme.
Delibere • Nathalie Peyrebonne
Dix bonnes ou mauvaises raisons de lire No no boy
1. No no boy, publié à l’origine en 1957, est l’unique roman de John Okada, Américain d’origine japonaise mort à l’âge de 48 ans et dont la femme a brûlé le deuxième roman.
2. Point de départ du récit : après l’attaque de Pearl Harbor, en 1941, les hommes, les femmes et les enfants d’origine japonaise installés sur le sol américain ont été internés dans des camps. « Le septième jour du mois de décembre de l’année 1941 fut celui où les bombes japonaises tombèrent sur Pearl Harbor. À compter de cet instant, les Japonais des États-Unis devinrent des animaux d’une espèce différente, en vertu d’une couleur de peau dont ils ne pouvaient se défaire et d’yeux bridés qui, à y regarder de plus près, paraissent rarement tels. »
3. Par la suite, le gouvernement a fait remplir aux jeunes garçons internés un questionnaire leur demandant s’ils étaient disposés à rejoindre l’armée américaine et à prêter allégeance aux États-Unis. Certains répondirent non. Deux fois. D’où leur surnom : les no no boys. Ils furent envoyés en prison. Le roman suit le parcours de l’un d’entre eux, Ichiro Yamada, vingt-cinq ans, à partir du jour où il rentre chez lui, à Seattle, après deux ans de camp et deux ans de prison.
4. Alors bien sûr le motif central du roman tournera autour des tensions raciales à l’œuvre, pas seulement à l’égard des Japonais d’ailleurs. Dans le roman de John Okada, les bars comme les rues sont des terrains minés où la couleur de la peau et l’appartenance plus ou moins pure à telle ou telle communauté peuvent conduire en enfer.
5. Le roman, qui jamais ne tombe dans les travers du manichéisme, ne cesse de démontrer à quel point les parcours, les vies et les ressentis peuvent être différents même partis d’un point commun, à quel point des choix divergents peuvent être fait, à quel point ils peuvent entraîner haine et incompréhension. Il y a Américain et Américain, comme il y a Japonais et Japonais (« ce ne sont pas des Japonais comme nous. C’est juste une dénomination qu’ils se donnent »). Et il y a bien de la souffrance.
6. Il évoque aussi ce que c’est qu’une famille, et en particulier une famille en exil, où des générations se succèdent qui peu à peu n’ont plus les mêmes références, plus le même pays : « Puis vint un temps où je ne fus plus qu’à demi-japonais, parce que personne ne peut naître en Amérique, grandir en Amérique, aller à l’école en Amérique, parler, jurer, boire, fumer, jouer, se battre, regarder et écouter en Amérique, parmi les Américains, dans les rues, les maisons d’Amérique, sans devenir américain et aimer cela. »
7. Il raconte les déchirement internes de celui qui ne peut plus savoir qui il est : « Je souhaiterais de tout mon cœur être soit japonais, soit américain. Mais je ne suis ni l’un, ni l’autre, et je t’en veux, et je m’en veux, et j’en veux à un monde fait de pays bien trop nombreux, qui se combattent les uns les autres, s’entretuent, se haïssent, se détruisent mais jamais complètement, pour pouvoir remettre ça, tuer, haïr, détruire, encore et toujours. »
8. C’est un roman dont il est difficile de rendre compte, tant la réflexion historique et sociologique, centrale dans le récit, pourrait sembler prendre le pas sur tout le reste, tant le sujet en semble sec et barbant. Alors que, étonnamment, c’est d’abord et avant tout un texte troublant de par ses qualités littéraires, émouvant par la subtilité de sa prose, aérien par la délicatesse de ses dialogues et de ses descriptions.
9. Le récit dessine, au fil des pages, des portraits tout en nuances, en installe certains de façon durable, en frôle d’autres. Des figures qui ensuite hantent celui ou celle qui aura eu le bonheur de lire ces pages.
10. C’est un texte qui parle de tout sauf d’un épisode historique précis, quoique bien sûr ce soit évidemment le cas. Tout en étant à la fois cruel, dur et terriblement émouvant.
ISBN : 9782373852271
ISBN ebook : 9782373852325
Collection : La Grande Collection
Domaine : États-unis
Période : XXe siècle
Pages : 480
Parution : 15 octobre 2020