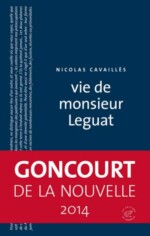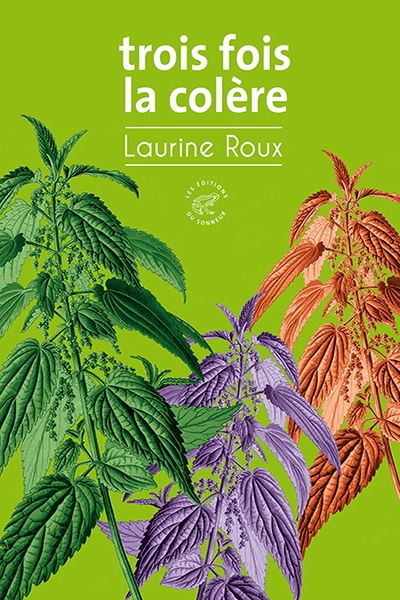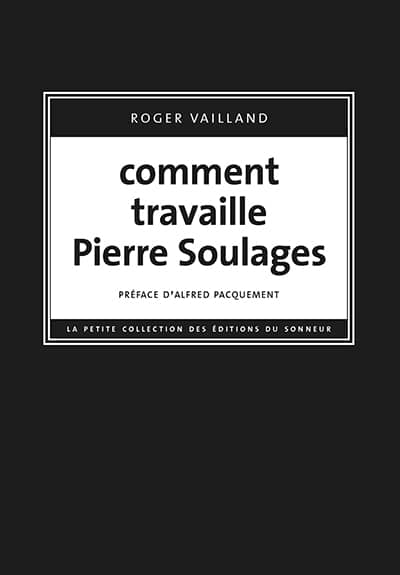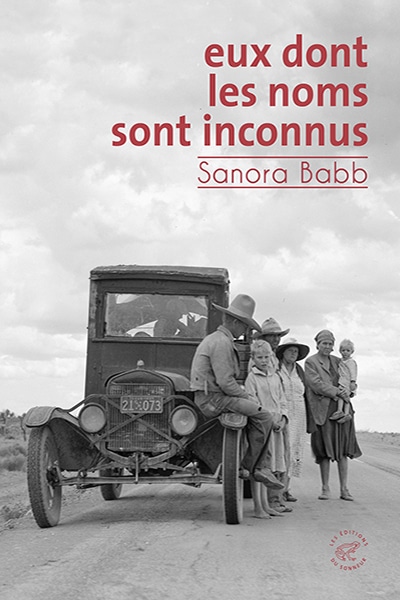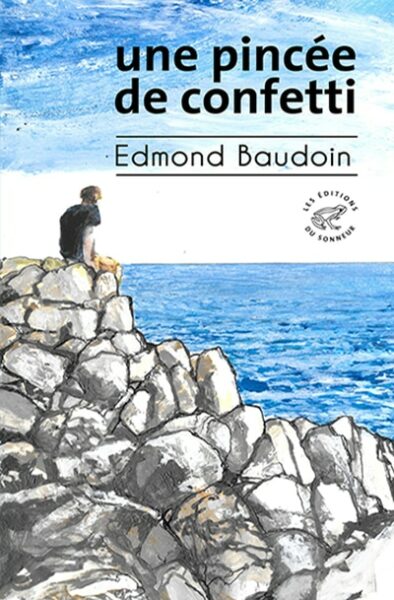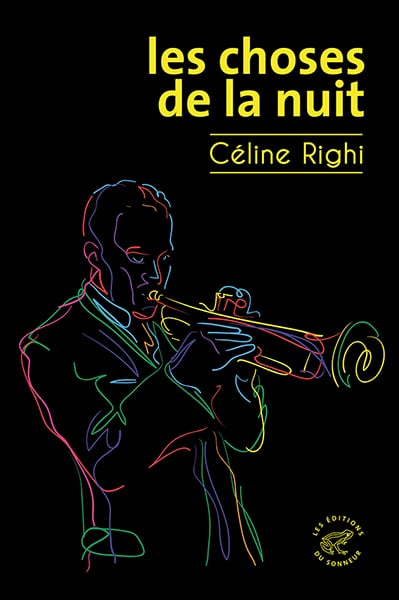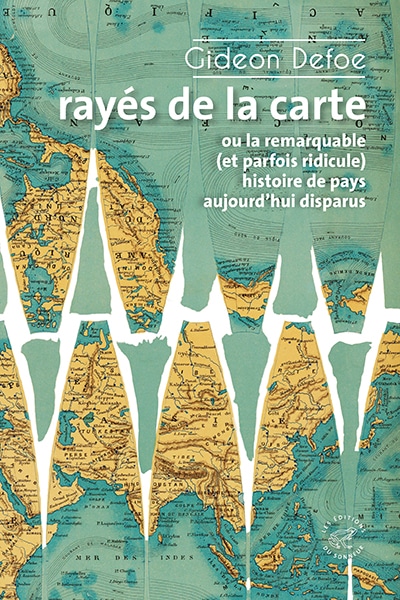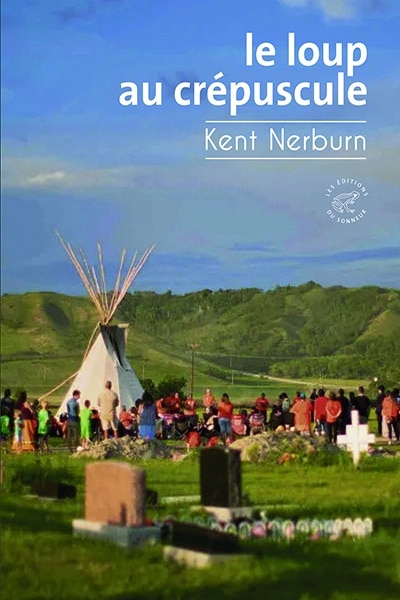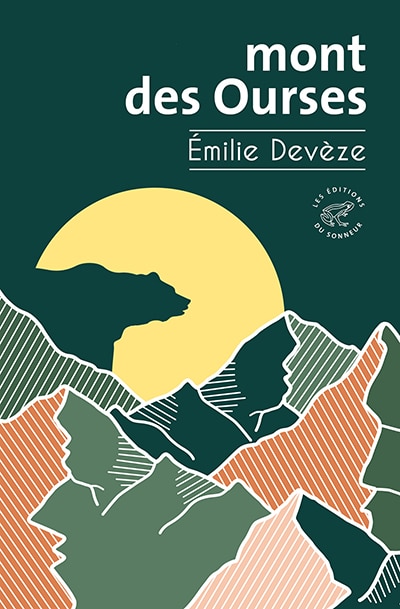Le Mort sur l’âne
Nicolas Cavaillès
« Il était impossible, hélas, qu’une île de mille huit cents kilomètres carrés restât immaculée : sur cette miette égarée de l’Afrique ou de l’Inde, Dame Nature ne fit naître aucun aborigène, mais l’humain ne put s’empêcher de venir s’y promener et y vivre, d’en violer la barrière de corail. Il n’est guère plus envisageable, hélas, que tous les habitants de notre île, absolument tous, acceptent un jour de la quitter, de la rendre à sa pureté originelle – celle des déserts, de Dieu ou du Néant. Le miracle serait déjà formidable, qui empêcherait qu’aux riverains ne s’ajoutent chaque jour, flux et reflux diarrhéique via le côlon aérien, les milliers de touristes venus la souiller quelques jours et la fuir à jamais. »
Au gré des pérégrinations d’un âne, Nicolas Cavaillès dresse un portrait atypique de l’île Maurice. Un voyage à l’intérieur de ces terres à la toponymie si particulière, propice à une réflexion menée avec humour sur l’idée paradoxale que la civilisation, dans son appétit de découvertes et dans son effort pour rendre le monde toujours plus « vivable », fait en réalité œuvre de destruction.
Né en 1981, Nicolas Cavaillès est l’éditeur de Cioran dans la Pléiade (Gallimard, 2011) et l’auteur de Vie de monsieur Leguat qui a remporté le prix Goncourt de la Nouvelle 2014 et de Pourquoi le saut des baleines, Prix Gens de mer 2015, Les Huit Enfants Schumann, mention spéciale du jury du Prix Françoise Sagan et du Mort sur l'âne.
Guillaume Contré, Le Matricule des anges
Dans un texte qui fait de la digression son armature, Nicolas Cavaillès tisse un portrait sensible de l’île Maurice en suivant les pas lents d’un curieux âne…
Comment parler d’un territoire qui peut s’avérer aussi précis que fantasmé, comment approcher sa diversité, son histoire, les tensions et les conflits que son existence suppose, comment évoquer sa beauté comme sa misère sans tomber dans les généralités toujours trop vagues, dans les grands discours factices et les métaphores creuses ? Comment parler, pour tout dire, d’une réalité quand la question de la légitimité de celui qui parle – son autorité, si tant est qu’il en ait une – peut forcément être mise en doute ? Voici des questions que non seulement Nicolas Cavaillès semble s’être posées au moment d’écrire Le Mort sur l’âne, mais auxquelles il a su trouver des réponses adéquates.
Ce livre difficile à classer (ce n’est ni un roman, ni une chronique, ni un reportage ; plutôt une errance réflexive, une dérive géographique, par moments fable, à d’autres un essai) a pour objet l’île Maurice et comme personnage un âne qui « s’achemine vers l’aurore de sa nuit d’errance ». Celui-ci, en effet, tandis qu’il se trouvait tranquillement attaché à un piquet au fond d’un cratère éteint, se trouve soudain alourdi d’un « fardeau informe, long et lourd », fixé par « trois tours de corde ». En réalité un cadavre en état avancé de putréfaction dont des inconnus se débarrassant en le confiant à une pauvre bête qui croyait naïvement pouvoir finir ses jours en paix. Le fil conducteur d’un récit qui n’est que digression (signalée voire soulignée par de courts chapitres qui ne cessent de se démultiplier en bis, ter voire quater) devient la dérive nocturne d’un mulet qui avance à tâtons et quitte son cratère pour nous offrir une visite guidée de l’île Maurice, cette « pyramide en ruines ».
Mais l’âne, bien sûr, n’est pas le vrai personnage du livre et l’île Maurice n’est peut-être pas tant l’objet du texte que le prétexte géographique offert à l’écrivain pour traiter son sujet par la bande, à travers la question toponymique, comme s’il s’agissait de « dresser la liste de tous les lieux que l’île recèle dans son chaos ». Territoire originellement vierge de tout habitant, perdu entre Inde et Afrique, colonisé par des Français et des Anglais, l’île porte dans le moindre de ses noms, tour à tour fleuris, absurdes ou inquiétants, les marques d’une histoire qui s’y dessine comme autant de couches d’un calque plus ou moins translucide. Ainsi, le narrateur qui n’est peut-être pas Cavaillès mais est sans doute le vrai personnage du livre, nous confie-t-il (nous « assène »-t-il) « (s)es vues et (s)es doutes sur tous les trous et autres noms de villes et de village de notre île », ce qui le force à s’accrocher comme il peut au personnage de l’âne pour ne pas « sombrer plus profondément dans l’obsédante géographie qui l’entoure ». L’île, d’origine volcanique, est de fait « trouée de tous les côtés » : Trou-au-cerf, Trou-Kanaka, Trou-de-Madame-Bouchet, Trou-aux-biches, etc. On lit les cartes, la géographie et les noms « dans l’espoir de nous y retrouver nous-mêmes, de ne pas nous sentir exclus ni étranger », voire d’y trouver « une nouveauté susceptible sinon d’orienter notre avenir, du moins d’éclairer la parcelle suivante, qui vient déjà, de notre présent. »
Le cadavre arrimé contre sa volonté au dos de l’âne pourrait être une métaphore que l’auteur se garde bien de trop définir (car définir, ici, serait réduire). Celle par exemple de la putréfaction inhérente à toute idée de civilisation, comme si l’âne c’était l’île Maurice, « ce petit paradis touristique et fiscal », et le cadavre des couches de béton et les hordes de touristes qui la font ployer. Un « paradis » grevé de « poches de pauvreté » comme autant d’autres trous béants (quoique cachés), mais dont les noms, là encore disent beaucoup.
L’âne, entre-temps, poursuit sa route en supportant comme il peut sa charge nauséabonde. Il faudra bien qu’il arrive quelque part. « Et pourtant », s’interroge l’auteur ou la narrateur, dont l’identité reste élastique, « ces lieux que l’âne traverse, ne sont-ce pas les mêmes que l’humain croit connaître et posséder parce qu’il les a nommés, mesurés, inscrits dans l’histoire ? » le lieu d’arrivée de l’animal pourrait d’ailleurs correspondre lui aussi à un nom inscrit dans l’histoire, qu’importe qu’elle soit petite ou grande.
Un dernier livre avant la fin du monde
« Brit Haa », c’est le cri du principal protagoniste de cette histoire : un vieil âne de l’île Maurice, qui n’aspire qu’à finir ses jours tranquillement – jusqu’à ce qu’un soir, on lui attache un cadavre sur le dos. La puanteur et le poids de cette charge entraînant le pauvre animal dans une course effrénée, voici le fil conducteur qui nous mènera d’un bout à l’autre du roman de Nicolas Cavaillès, pour un voyage à l’intérieur des terres de l’île Maurice, aux côtés d’une bête en proie à la confusion, et d’un narrateur pour le moins expansif.
En effet, l’âne et le mort qu’il charrie sur son dos sont surtout prétexte aux monologues impromptus d’un conteur invasif – qu’il se fasse guide touristique du territoire de l’île dont il égrène les noms de lieu, les anecdotes, et autant de réflexions que cela lui inspire, qu’il s’improvise historien ou encore biographe, romançant par exemple une anecdote de jeunesse de Baudelaire, ou relatant la vie et la mort tragique du musicien Kaya.
Formellement, le texte est à l’image du parcours erratique de son personnage, empruntant des détours constants, qui s’étalent volontiers sur plusieurs courts chapitres avant que le narrateur ne se résigne à reprendre le fil de son histoire.
L’hostilité poisseuse de ce chaos attisa sa rage, mais lorsqu’il voulut donner à sa fuite un nouveau rythme, plus rapide, l’âne qui ne savait pas comment s’extirper de là se retrouva soudain hors de la forêt, sur le chemin de crête du cratère.
La légende veut qu’il se soit alors mis à marcher sur ce sentier circulaire, et qu’il en ait fait plusieurs fois le tour, sans s’arrêter, plusieurs heures durant, les yeux à terre, concentré sur son progrès permanent, attendant mystérieusement que survienne une solution à son problème de cadavre – comment s’en débarrasse
Par son dispositif d’énonciation, son usage de la figure animalière, ou encore par sa forme, courte, Le Mort sur l’âne se présente à nous comme un apologue, longue fable ou conte philosophique. Nous autres, lecteur/ices, serons comme naturellement tenté-e-s de percer la métaphore de l’âne qui cavale avec un mort sur le dos, pour en dégager un sens. Une analogie de la vie comme fuite déboussolée vers la mort, peut-être, voire de la condition humaine en général ? Cet âne ne serait-il pas une sorte de Sisyphe ?
Ou bien, puisqu’il s’agit, aux dires du narrateur, d’une vieille légende créole qu’il s’est donné pour mission de nous raconter, c’est sans doute qu’une vérité se cache sous la tradition orale : quelque chose comme l’identité d‘un pays, l’essence d‘une culture et d‘une histoire.
En fait, bien malin qui pourrait percer la symbolique de ce récit, qui se dérobe sous nos tentatives d’en figer une interprétation. Le narrateur ne cesse d’ailleurs de s’attaquer, précisément, à la valeur philosophique alléguée aux récits, aux noms et aux signes.
S’il se dégage de ce livre une portée axiologique, elle concerne moins la trajectoire du personnage principal (qui se caractérise d’ailleurs par une absence totale de compréhension de ce qui lui arrive), que les paysages qu’il traverse, support des considérations et des obsessions du narrateur. Or, celles-ci ont pour objets communs, d’une part, le rôle néfaste de l’homme, tant sur le plan matériel que symbolique ; et d’autre part, le vide, la béance constitutive de toute existence terrestre.
Si maintenant vous me demandez d’où vient cette brèche, je vous répondrai que c’est l’humain, jeté ici-bas comme un touriste sans guide, qui se l’est percée tout seul face à l’immense mutisme de son univers : élan mystique ou rigueur administrative, accès poétique ou besoin de se rassurer, il a voulu combler le silence, il a donné aux lieux des noms – et les lieux ont crevé comme de vieux pneus. Tout ce qui s’en est suivi, tautologies et malentendus, fantasmes et déceptions, délires et hurlements, tout procède d’un vide initial qui est l’absence de l’humain dans la démiurgie de la Terre qu’il veut et croit posséder. Au Trou-aux-Cerfs, il n’y a plus ni cerfs ni aristocrates en costume de chasse : seuls restent le trou en quoi ils ont tous sombré, et son nom, leurre prosaïque échouant à pallier son absence d’identité.
Foncièrement pessimiste, le narrateur évoque les apports et les transformations matérielles apportées à l’île par les hommes, au cours de l’Histoire, et en dresse un bilan peu glorieux : l’introduction d’espèces vouées à l’exploitation et au travail, comme les ânes, la destruction d‘autres espèces, comme le dodo, et, aboutissement suprême de cette invasion occidentale, des flots continus de touristes interdisant toute jouissance de la nature sauvage de l’île.
Sceptique au sens philosophique du terme, il met également un frein à toute velléité d‘identification anthropomorphique, et dénie tout fondement à l’acte d‘appropriation des choses par le langage : il nous raconte combien les noms assignés aux lieux tiennent de l’anecdotique, du contingent, et disent à la fois toute la futilité, l’égotisme et la prétention des hommes dans leur rapport à la nature.
La toponymie de l’île l’illustre à merveille : mi-description géologique tenant de l’évidence (le trou), mi-importée de faits humains insignifiants, forcément tombés dans l’oubli. Non contentes d’être d’une absolue inanité, ces dénominations arbitraires que sont les noms détruisent la nature qu’elles prétendent essentialiser. Sur l’île Maurice, toute volonté humaine à construire du sens achoppe sur une nature aux reliefs indisciplinés, irréductibles, rétive à la projection des fantasmes – ceux du géographe comme ceux du poète.
Tous les efforts que je fais seront déçus, et les fatigue et lassitude qui s’ensuivront accroîtront mon amertume, et cette spirale n’aura de fin qu’au moment où je cesserai d’aller quelque part, où je refuserai aux lieux l’illusion d’une identité propre, d’une existence abstraite : partout le même néant sauvage, indomptable, qui ne change de nature et d’apparence que dans mon esprit lâche et qui ne saurait faire de moi autre chose qu’un étranger, un colon, un usurpateur, sédentaire par faiblesse, exploitant par vilenie. Rien n’est à moi, nulle part le monde n’est ma maison, et tous les drapeaux que j’y plante ne flottent que dans le vent de mon égotisme, pour mieux retomber et s’enrouler autour de leur piquet lorsque mes illusions s’effritent.
Le Mort sur l’âne s’inspire allègrement du nihilisme et de la philosophie du désespoir de Cioran. Nicolas Cavaillès est d’ailleurs traducteur et spécialiste du philosophe roumain, et certaines de ses pages pourraient passer pour des pastiches.
Alors, comme chez Cioran, il ne faut pas sous-estimer la part d’humour et de dérision, constitutives du style et du propos de ce livre. Ainsi, l’ambivalence est au cœur du texte, dont l’ironie semble hanter chaque ligne : l’écrivain-narrateur s’écoute parler, il le sait, il en joue. Se crée ainsi une sorte de connivence, avec le/la lecteur/ice, qui donne au texte tout son charme.
Ainsi en va-t-il de tous ces noms de lieux : dénigrés pour leur vacuité, on se complaît malgré tout dans leur recensement, et d’ailleurs l’auteur semble en faire l’inventaire pour le pur plaisir de les faire sonner, ou de s’aventurer dans des hypothèses de sens farfelues. Critiquant l’inanité du langage, il peut en jouir autant qu’il la déplore : émane alors du récit, de ses considérations sur le néant et la mort comme de ces énumérations de noms de lieux et de pays, une beauté poétique insolite.
Conte philosophique à la morale introuvable mais à l’esthétique manifeste, Le Mort sur l’âne prend donc un malicieux plaisir à nous balader (dans tous les sens du terme), au grès d’un périple dont la finalité n’est finalement nulle part ailleurs qu’en lui-même, pour la beauté de la langue et des paysages.
ISBN : 9782373850741
ISBN ebook : 9782373850901
Collection : La Grande Collection
Domaine : Littérature française
Période : XXIe siècle
Pages : 128
Parution : 18 janvier 2018