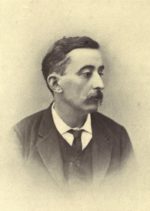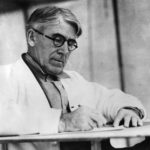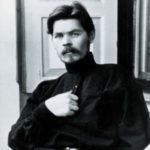Lafcadio Hearn est né en 1850 en Grèce, d’une mère grecque et d’un père irlandais. À peine adulte, il part tenter sa chance à Londres puis aux États-Unis. Il devient correcteur à Cincinnati, où il commencera dès 1874 à rédiger des reportages à sensation pour The Inquirer, avant de partir pour la Nouvelle-Orléans. De cette époque datent ses premières publications en volume : deux recueils de contes, Feuilles éparses de littérature étrange et Quelques fantômes chinois, ainsi que des ouvrages consacrés à la culture créole. Il s’installe à la Martinique en 1887 et y demeure jusqu’en 1889, le temps de collecter les récits et croquis de Deux ans dans les Antilles françaises et d’écrire deux romans, Chita et Youma. Puis il gagne le Japon, sa dernière patrie, où il écrit plus d’une dizaine d’essais et de recueils de contes. Il meurt en 1904, quelques mois après la publication aux États-Unis de son recueil le plus connu, Kwaidan.
Rôle : Auteur
Zane Grey
Né à Zanesville, dans l’Ohio, en 1872, Zane Grey passe une bonne partie de son enfance à cultiver ses deux passions, la pêche et l’écriture (il était grand lecteur de romans d’aventures). Excellent joueur de baseball, il doit cependant se résigner à devenir dentiste, comme son père. Marié en 1905 à Dolly Roth, il se consacre enfin pleinement à l’écriture grâce à l’assistance financière de sa femme. Après quelques échecs (ses quatre premiers romans sont refusés), il connaît la célébrité avec The Heritage of the Desert (1910) et surtout avec Les Cavaliers des canyons (1912), son plus grand succès, et l’un des westerns souvent défini comme le « plus populaire de tous les temps ». Suit une carrière d’une extraordinaire productivité – quatre-vingt-dix livres, dont une partie sera publiée à titre posthume : pour l’essentiel, des westerns, mais aussi des livres sur la chasse, la pêche et le baseball. Globe-trotter et pêcheur acharné, mari infidèle, âme tourmentée, l’écrivain prolifique meurt en octobre 1939 en Californie.
Grey est une source constante d’inspiration pour l’industrie cinématographique : ont été tirés de ses romans plus d’une centaine de films – Les Cavaliers des canyons ont donné naissance à cinq films entre 1918 et 1996.
Yves Gourvil
Né en 1950, Yves Gourvil est comédien et metteur en scène. Serait-ce le compagnonnage de tant de grands textes et personnages rencontrés de scènes en scènes qui l’a conduit à l’écriture ? Requiem des aberrations est son premier roman.
Maxime Gorki
Alekseï Maksimovitch Pechkov (1868-1936), élevé dans la pauvreté, exerça de nombreux petits métiers avant de se consacrer, à partir des années 1890, à l’écriture sous le pseudonyme de Gorki, l’« amer ». Romancier des vagabonds et des déclassés, ses idées révolutionnaires le conduisirent en prison, puis à l’exil à diverses reprises. Auteur de romans (dont le plus connu est La Mère), de contes, de nouvelles et de pièces de théâtre (dont Les Bas-Fonds, adapté au cinéma par Jean Renoir et Akira Kurosawa), il s’éteignit en URSS, qu’il avait regagnée en 1929.
Arthur de Gobineau
Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) étudie très tôt les langues et cultures orientales. En 1937, il se rend à Paris et, sans fortune, travaille à la Compagnie du gaz, aux Postes et écrit des articles et romans-feuilletons pour divers journaux dont La Revue des Deux Mondes et La Quotidienne. Il est remarqué par Tocqueville et devient son chef de cabinet en 1849, lorsque celui-ci est nommé ministre des Affaires étrangères. Il débute alors une carrière diplomatique qu’il ne quittera plus. Nommé successivement en Allemagne, en Iran, en Grèce, au Brésil, en Suède, il meurt à Turin le 13 octobre 1882.
Martha Gellhorn
Née en 1908 aux États-Unis, Martha Gellhorn se destine très tôt à l’écriture. En 1936, elle part pour l’Europe, accréditée par le magazine Collier’s pour couvrir la Guerre d’Espagne — où elle retrouve Ernest Hemingway, son futur époux. Elle devient alors au fil des années l’une des plus éminentes reporters de guerre du vingtième siècle : Seconde Guerre mondiale (elle pénètre dans le camp de Dachau peu de jours après sa libération), guerre du Viet Nam, guerre des Six-Jours, intervention américaine au Panamá… Et si à plus de 80 ans, elle se résigne à ne pas couvrir la guerre en Bosnie, elle se rend tout de même au Brésil pour enquêter sur des meurtres d’enfants des rues. Femme entière, d’une grande exigence morale, elle refuse le déclin de la maladie et décide l’année de ses 90 ans de se donner la mort. Depuis 1999, un prestigieux prix de journalisme porte son nom.
Théophile Gautier
Si Théophile Gautier (1811-1872), « le poète impeccable, le parfait magicien ès lettres françaises » selon Baudelaire, est réputé pour son romantisme flamboyant, c’est aussi l’un des plus grands auteurs français de contes fantastiques. Avatar, longue nouvelle parue en feuilleton en 1856, est l’une de ses œuvres les plus abouties — et pourtant oubliée. Ici, la recherche formelle de l’écriture côtoie la fascination pour le merveilleux et les sciences occultes et, sous la légèreté apparente du propos, se dessine un besoin irrépressible de s’évader du temps et de la mort.
Clotilde Escalle
Clotilde Escalle est née à Fès, au Maroc, où elle passe l’essentiel de sa jeunesse. Elle s’évertue depuis à dire l’exil, l’ailleurs, les marges, mais aussi la pulsion animale. Auteure de plusieurs romans (notamment Où est-il cet amour, Pulsion, La Vieillesse de Peter Pan), également dramaturge, Clotilde Escalle exerce par ailleurs comme critique d’art.
Jérôme Lafargue
Jérôme Lafargue est né en 1968 dans les Landes, où il vit. Il publie des romans, des nouvelles, parfois des poèmes, depuis une dizaine d’années. Son premier roman, L’Ami Butler, est un hymne enjoué à la littérature et annonce les suivants, tous portés par une écriture ardente, sensuelle. Jérôme Lafargue y traque l’amour, l’illusion et la mélancolie. À la question « Qu’attendez-vous de la littérature », il répond du tac au tac : « Seulement le plaisir. »
François Place
François Place est né en 1957 à Ezanville, en banlieue parisienne. Après un bac littéraire, il fait des études à l’école Estienne. Il travaille quelques années comme illustrateur indépendant pour des studios de graphisme et de publicité. En 1985, il rencontre Pierre Marchand, fondateur de Gallimard Jeunesse, qui remarque son travail. Il écrit et illustre alors une série de livres documentaires sur le thème des voyages et de la découverte du monde ; il illustre aussi des romans, dont ceux de Michael Morpurgo. Depuis 1992, date de la publication des Derniers géants, François Place construit une œuvre (romans et albums) autour du thème des voyages, de l’ailleurs, de l’autre. Ses illustrations sont régulièrement exposées à la galerie L’Art à la Page.